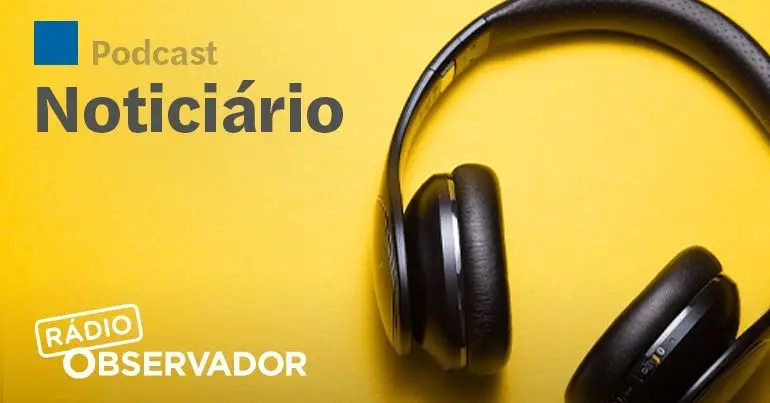Sommes-nous vraiment libres ?

La liberté occupe aujourd'hui une place centrale dans le discours politique moderne, jamais vue auparavant. Pourtant, c'est aussi l'un des concepts les plus mal compris et, dans une certaine mesure, manipulés. On entend souvent dire que nous sommes libres parce que nous pouvons nous exprimer, aller où bon nous semble ou voter sans restriction. Pourtant, en approfondissant cette question, on se rend compte que la liberté politique ne se résume pas à faire ce que l'on veut. Au contraire, la liberté est la garantie de ne pas être contraint de faire ce que l'on n'a pas le droit de vouloir.
Montesquieu, l'un des grands architectes de la pensée politique moderne, nous propose une perspective qui remet en question les conceptions superficielles de la liberté. Pour lui, la véritable liberté réside dans le respect des lois qui régissent la coexistence sociale, dans une sécurité juridique qui garantit l'autonomie individuelle sans arbitraire. Être libre, c'est pouvoir agir dans les limites imposées par la loi, qui n'a pas pour but de restreindre, mais de protéger la liberté de chaque citoyen.
Contrairement à l'idée répandue selon laquelle la liberté est une expression illimitée de la volonté, la liberté politique repose sur des structures solides qui protègent l'individu des abus, notamment dans le système judiciaire. La sécurité juridique, notamment dans le système pénal, est un pilier fondamental. Sans elle, la liberté se perd dans la crainte de persécutions injustes, l'absence de garanties procédurales et l'inégalité devant la loi. Une justice impartiale n'est pas un luxe ; c'est une condition indispensable à la liberté politique.
Nous sommes ici confrontés à une réalité inquiétante : les démocraties contemporaines, malgré leurs avancées, échouent souvent à garantir cette pleine liberté. L'arbitraire, la lenteur du système, les inégalités d'accès à la justice et l'ingérence politique dans les institutions judiciaires menacent la sécurité qui rend la liberté réelle et ressentie. Un citoyen soumis à un procès inéquitable peut, paradoxalement, être moins libre qu'une personne soumise à un régime autoritaire qui assure au moins un minimum de stabilité juridique.
Dans le débat public actuel, on observe une grande confusion entre liberté politique et liberté absolue, comme si le droit de faire ce que l'on veut était synonyme de liberté. Or, une telle liberté n'existe pas dans une société organisée. L'État de droit n'est pas un obstacle à la volonté individuelle, mais plutôt une garantie que la volonté de chacun n'est pas écrasée par l'arbitraire d'autrui, qu'il soit exercé par des dirigeants ou des groupes sociaux. Ce n'est que dans ce cadre de lois claires et d'une justice indépendante que la liberté peut véritablement s'épanouir.
Des questions subsistent : dans quelle mesure sommes-nous prêts à accepter les limites et les responsabilités qu’exige la liberté politique ? Combien reconnaissent que la liberté ne consiste pas à faire ce que l’on veut, mais plutôt à garantir que personne ne soit contraint de faire ce qu’il ne devrait pas vouloir ? Sommes-nous prêts à défendre des institutions qui garantissent la sécurité juridique, même lorsque cela contredit nos aspirations passagères d’impunité ou de liberté sans restriction ?
La véritable liberté n'est pas un sentiment ; c'est une condition concrète, fondée sur des règles, la justice et le respect mutuel. Si nous n'y prenons garde, nous risquons de réduire la liberté à un simple slogan , un masque dissimulant un pouvoir arbitraire et instable. La véritable liberté commence par la loi, et c'est sur cette base que nous devons concentrer notre combat.
Il est crucial de reconnaître que les acquis démocratiques sont fragiles et exigent une vigilance constante. La liberté politique, loin d'être acquise, repose sur une architecture institutionnelle qui non seulement crée des lois justes, mais les applique également de manière équitable et transparente. Le défi actuel consiste à défendre ces institutions contre les pressions politiques, économiques et sociales qui tentent de subvertir leur rôle. Sans un pouvoir judiciaire indépendant et un système juridique fiable, ce que nous appelons liberté devient illusoire.
Par ailleurs, la liberté politique est confrontée à des menaces nouvelles et complexes dans le monde contemporain : le progrès des technologies numériques, la diffusion de la désinformation et la polarisation croissante sont susceptibles d’éroder l’espace public et de manipuler le consentement populaire. Ainsi, défendre la liberté implique également de protéger l’environnement démocratique où le débat se déroule selon des règles claires et dans le respect des droits fondamentaux. Dans ce contexte, le droit doit être actualisé pour répondre à ces défis, en veillant à ce que la liberté ne se transforme pas en chaos ou en tyrannie de la majorité.
En fin de compte, la réflexion proposée n'est pas une invitation au pessimisme, mais un appel à la responsabilité civique et à la construction d'une liberté mature et durable. Il est impératif d'abandonner les discours simplistes et de rechercher une compréhension plus profonde qui privilégie l'équilibre entre droits individuels et bien commun. C'est ainsi que la liberté politique peut véritablement tenir ses promesses – non pas comme un fantasme d'autonomie illimitée, mais comme une réalité vivante et tangible pour tous.
observador