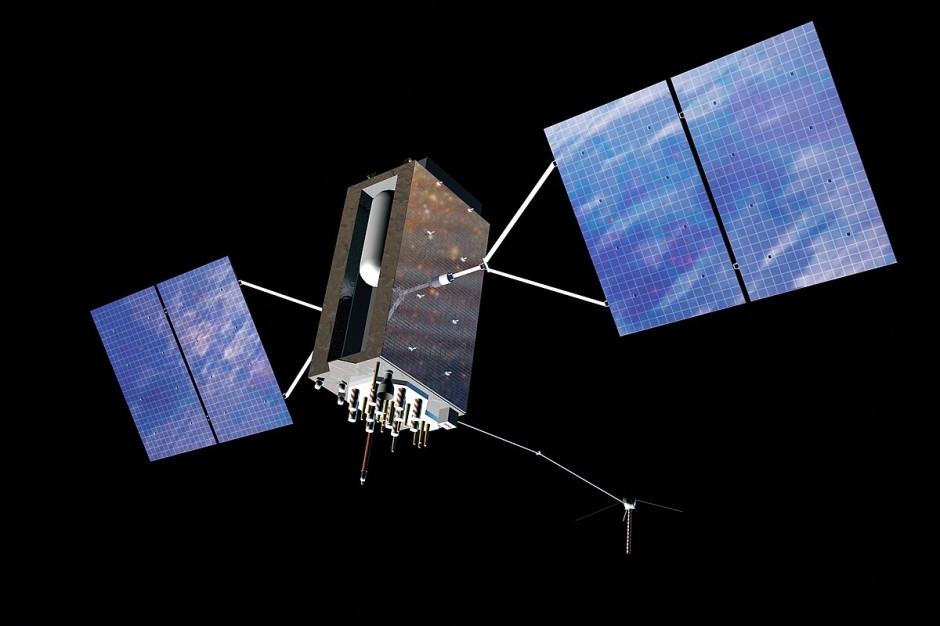La brigade de chameaux mauritanienne qui patrouille le Sahara pour empêcher les djihadistes et leur idéologie de franchir la frontière

Dans la cour d'un fort couleur sable, flanqué de quatre miradors pointus, M'Beirik Messoud scrute les alentours à travers le canon poli de son Kalachnikov. Général de brigade dans l'armée mauritanienne, Messoud doit passer les prochains jours à patrouiller le désert à la frontière malienne, où se cachent des djihadistes. La région frontalière qu'il traverse avec son équipe est si inhospitalière que même les véhicules tout-terrain les plus robustes ne peuvent y accéder. C'est pourquoi Messoud et ses hommes ne traversent pas les plaines sablonneuses en 4x4, mais à dos de chameau.
Ils appartiennent aux Méharistes, une brigade spéciale de l'armée mauritanienne en Afrique de l'Ouest , dont les hommes se déplacent à dos de chameau. Leur campement se trouve à Achemime, dans l'est du pays. La route s'arrête ici, laissant place au désert, près des remparts de la forteresse.
Pour les éleveurs nomades qui parcourent cette région, les Méharistes et leurs bêtes sont un spectacle familier. Messoud et ses hommes sont à la fois soldats, médecins, policiers, agents de renseignement et conseillers.
Cette unité, qui compte environ 300 membres , a été créée par les Français en 1912, alors que la Mauritanie était encore une colonie. L'objectif de la brigade demeure inchangé : garantir la sécurité et le bien-être des habitants du Hodh Ech Chargui, vaste province de l'est du pays qui s'étend sur plus de 180 000 kilomètres carrés du Sahara.
Ces dernières décennies, une tâche cruciale s'est ajoutée : empêcher le djihadisme, qui se propage dans le reste du Sahel , de pénétrer en Mauritanie.
Dans la cour du fort, des provisions sont disposées : viande de chèvre séchée, eau, boîtes de thé et sacs d'un kilo de sucre. Le brigadier Messoud les répartit dans les sacoches que ses hommes placent sur les chameaux. Messoud, 55 ans, a un visage avenant, des lunettes et des pommettes saillantes. « Doucement, doucement », murmure-t-il à son chameau en montant en selle. L'énorme animal, pesant mille kilos, se cabre en grognant. « Ces bêtes ont leur caractère », reconnaît-il, un sourire aux lèvres.
Il n’y a pratiquement pas de routes ici, mais Messoud connaît la région comme sa poche. « Je suis né sur cette terre », explique-t-il. « Nous nous orientons grâce aux étoiles, au vent, à la végétation et aux couleurs du sol. » C’est précisément pourquoi il est si important que les Méharistes soient des gens de la brousse , souligne-t-il ; des gens du désert.
Aujourd'hui, la brigade de chameaux se dirige vers l'est, en direction du Mali voisin et au-delà, vers le Burkina Faso et le Niger. Ces dernières années, l'intégrisme islamique s'est propagé à une vitesse fulgurante dans ces pays du Sahel. En 2005, le terrorisme djihadiste a atteint la Mauritanie. Un groupe précurseur d' Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) a attaqué une caserne de l'armée mauritanienne, tuant 15 soldats. Cette attaque a fait de la Mauritanie le premier pays du Sahel à être victime d'une attaque djihadiste.
Dans les années qui suivirent, les terroristes purent planifier aisément attentats et enlèvements depuis leurs repaires du désert. L'État mauritanien ne conserva sa force que sur la côte, où se situe la capitale, Nouakchott. La centralisation du pouvoir offrit un terreau fertile à l'idéologie islamiste radicale dans l'intérieur aride et appauvri du pays.
Dans cette région, la présence de l'État était très limitée. « Les nomades vivent ici tellement isolés qu'ils manquent de tout », explique Messoud. C'est pourquoi ils sont vulnérables aux promesses des djihadistes.
Pour inverser la tendance, la Mauritanie a renforcé l'unité méhariste. Et avec succès : grâce notamment à elle, aucune attaque n'a été perpétrée sur le territoire mauritanien depuis 2011. « Nous portons l'État jusque dans les régions les plus reculées du pays », déclare Messoud tandis que son chameau se dirige vers le village d'Em Gheizine, à une cinquantaine de kilomètres du fort.
Pour enrayer cette spirale de violence, les méharistes interviennent comme médiateurs dans les conflits. Ils constituent la seule forme de gouvernement que Desha et les autres habitants de la région connaissent.
Le processus de radicalisation a débuté dans les années 1970, lorsque plusieurs pays du Golfe, comme l'Arabie saoudite, ont commencé à utiliser les pétrodollars pour faire venir des étudiants du Sahel afin d'étudier le « véritable » islam et la charia. On leur enseignait la doctrine salafiste, également connue sous le nom de « salafisme wahhabite », qui considère l'islam soufi modéré pratiqué au Sahel comme païen.
À leur retour chez eux, ces étudiants reçoivent une aide pour fonder, entre autres, des écoles coraniques et des mosquées. « Si l’État est absent de ces régions, les djihadistes creusent des puits et aident la population », explique Messoud. Ils fournissent des services essentiels et, ce faisant, s’arrogent le rôle de l’État. « Ensuite, ils recrutent des jeunes », poursuit-il, « et leur offrent de généreuses récompenses s’ils rejoignent leur armée. »
examens médicauxLe village nomade d'Em Gheizine se dessine à l'horizon, sur les dunes de sable. Un homme court vers lui, surgissant de l'ombre d'un acacia. Sa daraa , une robe bleue, flotte au vent.
L'homme se présente comme Muheisim Desha, le chef du village. Il demande au médecin des meharistas, Famori Keita, de l'accompagner sous une tente multicolore. Là, ce sont surtout des femmes et des enfants qui attendent ; les hommes du village se déplacent de lieu en lieu avec le bétail et passent souvent des semaines loin de chez eux.
Pendant que le médecin ausculte les poumons d'une jeune fille qui tousse, Desha, le vieil homme, observe avec satisfaction depuis un coin. « Les médecins nous rendent visite environ tous les trois mois », dit-il, « ce qui facilite les examens réguliers. La clinique la plus proche est à plusieurs jours de voyage vers l'ouest. »
Le vieil homme explique que des conflits éclatent parfois entre les nomades de la région, par exemple lorsque des chameaux paissent sur un territoire qu'un autre groupe considère comme le sien. « Les groupes terroristes profitent de ces désaccords pour recruter des jeunes », explique-t-il. « Ils promettent de régler le conflit par la violence, ce qui oblige l'autre camp à s'armer lui aussi. »
Pour enrayer cette spirale de violence, les Meharistes interviennent comme médiateurs dans les conflits. Ils constituent la seule forme de gouvernement que Desha et les autres habitants des environs connaissent.
Au magasin, Keita termine son travail ; le médecin ne fait payer ni les médicaments ni les conseils. « Cela prouve que le gouvernement mauritanien se soucie de ses citoyens », affirme Desha.
Cependant, l'unité méhariste est largement financée par l'Union européenne. En 2019, une contribution européenne de 3,6 millions d'euros a permis l'acquisition de 250 chameaux et la construction du fort. Ces fonds servent également à former des centaines de nouveaux méharistes. L'Europe espère que cette aide financière empêchera les djihadistes de poursuivre leur expansion et de se rapprocher de son territoire.
Ce soir, les méharistes ont installé leur campement sur la crête d'une dune. L'air est saturé de sable. Les flammes d'un feu de camp crépitant se reflètent dans le thé qu'ils transvasent d'un verre à l'autre jusqu'à ce qu'une épaisse mousse se forme à la surface. L'un d'eux écoute de la musique sur son téléphone portable en fumant du tabac dans un os de chèvre évidé.

Soudain, un cri bref, aigu et étouffé retentit des ténèbres. Instinctivement, les miliciens saisissent leurs Kalachnikovs tandis que deux silhouettes émergent des buissons. Ils se détendent : les cris proviennent d'une chèvre qu'ils viennent d'abattre. L'animal est un présent offert par deux bergers de passage, « en remerciement de leur vigilance ». Les plus jeunes soldats suspendent la carcasse à une branche d'acacia épineuse pour la découper de haut en bas.
« Nous défendons notre patrie »Au matin, après une nuit froide à la belle étoile, les hommes étirent leurs membres engourdis et dénouent les cordes qui liaient les pattes des chameaux pour les empêcher de s'enfuir. Les selles, qui leur avaient servi de brise-vent pendant la nuit, sont remises sur les animaux, et le groupe reprend sa route.
Une demi-journée plus tard, les méharistes s'arrêtent près d'un parterre de plantes succulentes aussi grandes qu'un homme. Pour grignoter, ils mangent la cervelle de la chèvre rôtie la veille. Messoud sort de sa sacoche les photos d'identité de ses quatre enfants ; sa famille vit à Nema, plus à l'ouest. Il fait ce travail pour eux. « Nous défendons notre patrie », dit-il. « Nous veillons à ce que nos enfants grandissent libres de la guerre et de l'oppression », ajoute-t-il.
« Voilà le secret des Méharistes », affirme Hassane Koné, spécialiste à l’Institut d’études de sécurité de Nouakchott. « Ils sont originaires des régions qu’ils protègent. » Ces cavaliers connaissent la région comme leur poche et, à l’instar du reste de la population, sont des musulmans pratiquants. « Nous commençons l’école coranique à quatre ans et nous connaissons les lois de la charia sur lesquelles repose notre constitution », explique Koné. « C’est pourquoi, lorsque quelqu’un arrive avec des idées radicales, nous savons à quoi nous attendre. »
Les Méharistes partagent la même religion, la même langue et les mêmes coutumes que les nomades qu'ils rencontrent en chemin. « Les soldats sont issus de cette communauté », explique Koné. « La population leur fait confiance, ce qui leur permet de recueillir des renseignements cruciaux pour le gouvernement. »
La méthode de collecte d'informations des méharistes se précise lorsque la caravane de chameaux approche de la frontière malienne. Soudain, deux cavaliers plantent leurs talons nus dans les flancs de leurs montures et s'éloignent du groupe au trot pour discuter avec un berger un peu plus loin. Leurs confidences restent secrètes, explique Messoud. « Les bergers sont nos yeux et nos oreilles », précise-t-il. « Leurs informations sont cruciales pour savoir qui circule dans la zone frontalière. »
Le groupe attend ses deux compagnons sur une dune de sable abrupte. « Voilà la frontière », dit Messoud en désignant des buissons à l'horizon. Parfois, ils aperçoivent les djihadistes. Il y a quelques mois, ils ont vu des panaches de fumée s'élever du côté malien et ont croisé des villageois. « Ils avaient dû fuir, leurs villages étaient en flammes », dit-il en soupirant.
Des familles entières se cachaient sous les rares buissons avec leur bétail et les quelques biens qu'elles avaient rassemblés à la hâte, raconte Messoud. Aujourd'hui, elles sont hébergées dans un camp de réfugiés près de Bassikounou, en Mauritanie.
Les gens leur font confiance, ce qui leur permet de recueillir des informations et des renseignements cruciaux pour le gouvernement.
Hassane Koné, spécialiste à l'Institut d'études de sécurité de Nouakchott
« Les Maliens que nous rencontrons sont terrifiés par les djihadistes », explique Messoud. « Mais ils craignent aussi l’armée malienne et ses mercenaires. » Cette peur souligne les différences entre le Mali et la Mauritanie : tandis que les armées des autres pays du Sahel imposent leur pouvoir par les armes et l’oppression, l’État mauritanien prend soin de ses citoyens. « Nous sommes des soldats, mais nous sommes aussi des travailleurs humanitaires. »
La méthode méhariste pourrait-elle aussi apporter la paix au Mali ? « Non », répond Messoud catégoriquement. « Là-bas, la guerre a fait trop de dégâts. Au Mali, il est trop tard pour appliquer la méthode mauritanienne. »
EL PAÍS