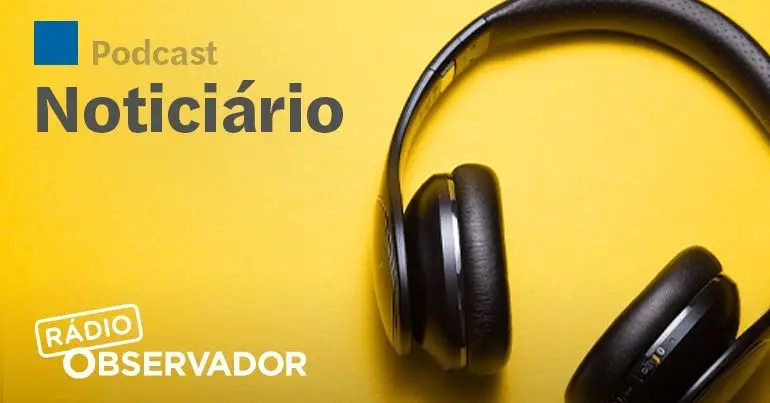L'illusion démocratique dans le monde pauvre

L'histoire montre que, dans les pays pauvres, la démocratie complète précède rarement le développement économique. Il serait peut-être judicieux de repenser l'ordre des facteurs.
Toutes les démocraties ne génèrent pas la croissance et, dans bien des cas, elles la freinent. Cet article remet en question la croyance bien ancrée selon laquelle le vote populaire est le moteur du progrès économique.
« Il n’existe aucun cas historique où un pays ait atteint le développement économique dans des conditions de démocratie de masse. » – Lipton Matthews
Cette phrase est choquante. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle doit être prise (très) au sérieux. Une analyse comparative de l'histoire du développement révèle une tendance qui peut inquiéter les sensibilités démocratiques contemporaines, je le sais. Mais, qu'on le veuille ou non, le fait est que les avancées économiques majeures ne se sont généralement pas produites sous des régimes pleinement démocratiques. Au contraire, les pays qui comptent aujourd'hui parmi les plus développés, ou qui ont connu une croissance rapide et soutenue, l'ont souvent fait sous des régimes autoritaires, technocratiques ou à faible participation politique.
Il s'agit d'une observation empirique, et non d'une apologie de l'autoritarisme. Mais il est important de la confronter avec réalisme politique.
Le problème semble résider dans le fait que, dans la plupart des pays pauvres, les démocraties de masse sont confrontées à trois obstacles structurels majeurs, à savoir :
1. Capacités réduites de l'État : les États fragiles sont incapables de garantir la sécurité juridique, les infrastructures de base, l'éducation ou les soins de santé. Sans institutions efficaces, la démocratie sombre rapidement dans le populisme, le clientélisme et la captation par des intérêts à court terme ;
2. Pression redistributive immédiate : dans les contextes de pénurie, les revendications démocratiques ont tendance à se traduire par des politiques de consommation rapide et de redistribution inefficace, souvent au détriment de l’investissement stratégique, de la discipline budgétaire et de l’épargne publique ;
3. Intérêts des élites : les élites économiques et politiques préfèrent souvent les régimes autoritaires stables qui garantissent la prévisibilité et le contrôle aux démocraties instables qui menacent leurs privilèges.
L'histoire récente de l'Asie est instructive. Sous la direction de Lee Kuan Yew, Singapour est devenue une icône du « développementalisme autoritaire » : méritocratie, discipline d'État, contrôle centralisé et tolérance zéro envers la corruption. Il n'y avait pas de démocratie de masse ; il existait plutôt un État fort, efficace et axé sur les résultats. La démocratisation n'est venue que plus tard, avec la prospérité et la consolidation institutionnelle.
Taïwan et la Corée du Sud ont suivi des trajectoires similaires : la croissance d’abord, l’ouverture politique ensuite. La Chine est aujourd’hui le cas le plus controversé et le plus étudié, et pour beaucoup, le plus inquiétant. Car elle démontre, avec une efficacité brutale, que les régimes autoritaires peuvent être très efficaces pour promouvoir la croissance, même au détriment des libertés fondamentales.
La science politique contemporaine n'ignore pas ces tensions. Des auteurs comme Samuel Huntington, Guillermo O'Donnell et Francis Fukuyama ont montré que la consolidation démocratique exige des conditions préalables : une bureaucratie fonctionnelle, un système judiciaire indépendant, une société civile relativement structurée et, surtout, un État qui privilégie sa démocratisation.
La question qui se pose n'est donc pas de savoir si la démocratie est souhaitable. Elle l'est ! La question est de savoir si elle est viable dans tous les contextes. Et, plus encore, si elle doit être considérée comme un point de départ ou un point d'arrivée.
Certains préfèrent ignorer ces tensions au nom d'impératifs moraux ou de convictions idéologiques. Mais les ignorer ne les élimine pas. Pire encore, cela contribue à exporter des modèles institutionnels dysfonctionnels qui s'effondrent au premier signe de crise. La démocratie, en tant que forme de gouvernement, est un artefact politique complexe. Elle requiert du temps, un capital institutionnel, une cohésion sociale minimale et (oui), une prospérité économique. Son épanouissement ne se décrète pas. Il doit être construit.
Car avant de se demander si un peuple est prêt pour la démocratie, peut-être devrions-nous nous demander si l’État est prêt à la soutenir.
observador